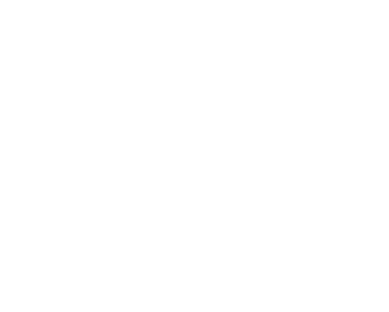Guy Girard
FOSSILES INSTANTANES DU DEVENIR
Cela pourrait faire la matière d’un nouveau mythe que cette expression désormais courante qui veut que nous soyons composés, ainsi que tout être ou toute chose dans l’univers, de poussière d’étoiles. Cette très poétique expression, mesurée à la pousse de mes cheveux ou de mes ongles, n’est pas sans me laisser plus que rêveur : je viens, moi aussi, d’un lointain ailleurs, du fin fond d’un univers en pleine explosion prénatale de l’autre côté d’une horloge atomique. Remonter mentalement le cours de ces âges d’avant le temps ? Si deux miroirs se faisant face donnent une image exemplaire de l’infini, lorsque je me place entre eux, je réinstaure le présent et ses limites spatiotemporelles, ce présent dans lequel je suis tout juste capable de casser un sablier et de répandre sa poussière sur mon ombre – geste conjuratoire pour mieux rêver et me laisser posséder, brièvement, par le lot d’ancêtres que je porte dans mes neurones, mes cellules osseuses et mes spermatozoïdes.
Ce lieu où je suis en ce moment, à la porte de Paris, était à l’ère secondaire sous les flots d’une mer tropicale qui très lentement se retira pour laisser place à un vaste marécage peuplé de gigantesques sauriens dont les divers ébats amusaient sans doute les déjà très vénérables libellules. Des fossiles de dinosaures ont été mis à jour sous la pioche des ouvriers creusant les galeries du métro, au début du vingtième siècle : le savoir paléontologique imprégnait alors suffisamment les esprits pour qu’on ne se risquât plus à prendre ces restes imposants pour des reliques de dragons. Cet animal fabuleux, d’espèce définitivement exterminée par les super-héros du christianisme naissant, n’a donc pas sa place dans les musées d’histoire naturelle, quoique ses multiples descriptions et ses représentations dans la littérature et l’imagerie médiévales offrent assez de vraisemblance les unes par rapport aux autres pour que les amateurs de cryptozoologie puissent avec un sérieux quasi-pataphysique enquêter sur les possibilités de son existence. Allez, on concèdera un jour à de si minutieuses débauches de l’épistémologie des sciences de la nature le pouvoir de stimuler de plus vastes domaines que l’esprit ludique qui pourtant règne encore dans certains laboratoires : alliée aux débordements de l’expérience onirique, ces spéculations aident à construire non pas une machine désirante à jouer avec le temps, mais à ouvrir dans la perception de celui-ci, des dimensions quasi-hallucinatoires qui élargissant le réel aux tourbillons de la conscience aux prises avec ce qui pourrait être nommé, sans angoisse superflue, l’éternel retour de l’autre.
La pensée poétique n’assure jamais mieux son empire que lorsqu’elle s’interroge sur cet autre, et qu’exaspérée par son propre abîme, elle provoque et presse la conscience de s’élargir jusqu’à prendre la forme de l’envers du miroir au travers duquel fait signe l’autre, l’inconnu mais non l’inconnaissable. La formidable assertion de Rimbaud a déjà été devinée par Taliesin («J’ai revêtu une multitude d’aspects / avant d’acquérir ma forme définitive ») et Paul Eluard s’est su rocher pour mieux se savoir homme. Cette aventure par excellence initiatique, où l’esprit se découvre mémoire et garant de toute métamorphose possible, pouvons-nous espérer en reconnaître quelques traces tangibles dans un monde devenant chaque jour plus insensé, plus insensible ? Le rocher que fut Eluard n’a certes pas été tout entier concassé pour produire cet amas de graviers qui recouvre son tombeau au cimetière du Père Lachaise, agrégeant autour de lui de renommées charognes staliniennes sous leurs cubes de granit. Et Rimbaud n’est pas plus à Charleville que Taliesin sous un tertre oublié sauf par les ronces et les jonquilles, quelque part au Pays de Galles. Non, ils sont aussi bien réunis tous les trois en quelque dimension onirique autour d’un festin de cuissots de mammouth, de ce mammouth dont le squelette poussiéreux se pavane dans la galerie de paléontologie du Jardin des Plantes. Et il me suffit de jouer avec cette idée pour que ma révolte devant cette civilisation capitaliste qui croit avoir soumis tout devenir à ses misérables routines, échappe joyeusement à la tentation nihiliste qu’insuffle l’air du temps…
Et puis, on peut beaucoup jouer au Jardin des Plantes ! A essayer de soulever, par exemple, l’énorme météorite noire qui se trouve dans une allée non loin de l’entrée de la Grande Galerie de l’évolution. On la croirait chue, non de la poche de Lucifer, mais d’une de ces peintures de Josef Sima dans lesquelles rôde le mélancolique polyèdre de Dürer. Je n’ai jamais touché cette pierre extra-terrestre qu’avec un vague sentiment d’effroi, reliquat sans doute des grandes frayeurs sacrées qui devaient saisir mes ancêtres les Gaulois et quelques autres, lorsqu’ils voyaient le ciel commencer de leur tomber sur la tête. N’est-ce pas dans un de ses romans qu’Abraham Merritt imagine qu’un monstre à forme de Kraken dort dans une semblable roche ? Pierre de grand mystère, dans laquelle, aussi, pourrait être fichée l’épée Excalibur ou la rapière du chevalier de Pardaillan ; mais que sur laquelle, surtout, ne soit jamais construit de temple ! Creusons-y plutôt une baignoire pour Marat-le-Mélusin…
Creuser : vieille habitude parisienne. La nature géologique du sous-sol s’y prête admirablement, faite principalement de calcaire et de gypse exploités des siècles durant dans des carrières souterraines dont une part est devenue catacombes et ossuaire. Légendaire labyrinthe qui a pu servir de refuge à bien des réfractaires à la loi et à l’ordre régnant en surface, et dans lequel la prodigieuse imagination de Gaston Leroux a situé l’utopie du peuple des Talpas, venu s’établir là au Moyen ge pour fuir l’iniquité féodale, et qui dans ces souterrains obscurs, dans ces détours du temps, a constitué une société communiste comme on rêve toujours d’en voir s’épanouir sous le soleil. Fossiles prémonitoires du devenir social ? S’ils ont bien accueilli, à la Belle Epoque, Théophraste Longuet, l’hurluberlu héros de Leroux, ces hommes-taupes auront-ils bientôt la chance de recevoir parmi eux quelque délégation de Gilets jaunes venus se mettre à l’abri de la flicaille et observer les mœurs d’une société émancipée ?
D’imaginer une telle situation pourrait conduire à l’invention d’un nouveau jeu subversif parmi le Mouvement surréaliste : il s’agirait de construire des simulacres de fossiles, qui seraient les fossiles d’une utopie qui aurait pu exister quelque part autrefois ou qui pourrait exister dans un futur antérieur. Eh, si nous retrouvions, par exemple en faisant des fouilles à Hauterives, à proximité du Palais Idéal du Facteur Cheval, le fossile (très bien conservé !) d’un de ces anti-lions rêvés par Fourier ? Ou même, quelque part du côté de Houston, là où Victor Considérant avait tenté de fonder un phalanstère, en creusant à moins de six mètres de profondeur, on aurait de bonnes chances de retrouver les tombes richement décorées des phalanstériens, et on pourrait constater, sans surprise excessive, que ces squelettes sont pourvus de la quantité d’os supplémentaires qui formaient l’archibras. Il serait intéressant de fabriquer de tels objets puis soit de les mettre en circulation, pour aiguiser les imaginations, ou de les enfouir en des lieux adéquats à la révélation future de leur déconcertant mystère. De même que la paléontologie, l’archéologie vaut d’être détournée, c’est-à-dire réalisée à des fins surréalistes.
On se souvient des photographies de Raoul Ubac montrant les fossiles de la Bourse ou de l’Opéra de Paris : ce que cela comportait de dimension critique, en dénonçant le caractère mortifère de ces célèbres monuments d’une société détestable, demande à être poursuivi par des moyens renouvelés. Mais la civilisation industrielle n’a-t-elle pas pris quelques millénaires d’avance sur nous en dispersant à travers le monde ses propres fossiles à longue durée que sont les déchets nucléaires ? Cependant les couvertures phosphorescentes des numéros du Surréalisme au service de la révolution ne sont-elles pas légèrement (très légèrement) radioactives ?
***
Il m’est souvent arrivé dans mes rêves de me trouver dans des paysages exubérants, des sortes de jungles tropicales, inspirées par le cinéma, mais il me revient maintenant en mémoire un rêve ancien, au cours duquel j’étais amené à tuer des mammouths, armé seulement d’une très longue épingle. Il parait que les progrès dans le domaine de la manipulation génétique permettraient de « ressusciter» cette espèce disparue de pachydermes. Mais le réchauffement climatique leur serait bien sûr une nouvelle fois fatal ; ainsi qu’au rhinocéros laineux, dont le produit de la tonte pourtant permettrait de tisser quelques beaux tapis et de tricoter des carmagnoles. Voilà sans doute à quoi s’occupaient nos ancêtres du paléolithique, lorsqu’ils ne dessinaient pas de cadavres exquis sur les parois de leurs cavernes. Ils ne s’ennuyaient certes pas, et ils eurent la chance, dit-on, qui dura plusieurs millénaires, de pouvoir faire l’amour entre voluptueux de Neandertal et libidineux de Cro-Magnon : pourrais-je au moins une nuit en rêve, connaître les délices d’une femme de Neandertal ! Façon de rejouer, au moins pour mon plaisir et mon édification, une scène primitive occultée de génération en génération, depuis qu’a été inventé le racisme et que les prêtres ont remodelé la fable du paradis terrestre.
Dans une série de rêves, dont le souvenir m’est toujours inspirant, je fus amené à visiter ou à explorer dans d’immenses souterrains assez lugubres, les restes d’une civilisation inconnue. Elle avait atteint un niveau de développement technique conséquent, à en juger par des épaves de machines dont l’utilité m’échappait tout à fait, de même que je ne comprenais rien des écritures hiéroglyphiques sculptées sur les murs. Il y avait des séries de portes que je ne franchissais pas : j’ai néanmoins su lors d’un des plus récents de ces rêves que l’ultime porte s’ouvrait sur l’Agarttha, cette cité mythique qui accaparait alors mon attention. Bien sûr, ces images oniriques sont tributaires de lectures de romans et bandes dessinées de science-fiction, de cette culture populaire se nourrissant des mythes et des légendes de l’Atlantide, de l’Eldorado, de Shangri-la. Elles sont aussi nourries des sensations plus ou moins fortes reçues lors de visites effectuées dans des usines désaffectées et des ruines industrielles. A un certain niveau d’émotivité et de rêverie active, ne peut-on d’ailleurs percevoir ces ruines comme celles d’une cité engloutie émergeant des profondeurs du temps, voire même d’un temps parallèle ? André Breton, dans les années 1930, affirmait que nulle usine n’offrirait jamais à l’imagination le trouble poétique délivré par les châteaux en ruines ; mes amis les surréalistes madrilènes voient pourtant avec une mélancolique jubilation – et je ne suis pas loin de partager leur avis – dans ces bagnes industriels enfin heureusement désaffectés des lieux maintenant appropriés à l’aventure poétique. Lieux qui s’ils sont hantés, le sont par le golem de l’exploitation capitaliste. On peut d’ailleurs observer que celle-ci, pour conjurer sans doute les malédictions culpabilisatrices de ce monstre fantasmatique, revêt maintenant dans de tels lieux les formes de l’industrie culturelle : combien d’anciennes usines sidérurgiques, de carreaux de mines sont maintenant des musées de la révolution industrielle où sont soigneusement édulcorés sinon effacés souvenirs et témoignages des luttes ouvrières d’antan !
De nos jours, sauf pour ceux qui y travaillent, les lieux de production deviennent invisibles, qu’ils soient délocalisés au fin fond de la Chine ou de l’autre côté du périphérique, en des zones neutralisées par leur fonctionnalité univoque. Mais tout le reste de l’espace géographique devient marchandise culturelle, dont le leurre de la brève possession est vendu à des troupeaux de consommateurs, touristes et badauds en ces pèlerinages de la réification dont un des premiers exemples, ce furent les visites organisées, une dizaine d’années à peine après Waterloo, sur le célèbre champ de bataille où la récompense de la visite se manifestait dans la trouvaille d’un fragment d’obus ou d’un sabre rouillé. Qu’auraient dit ces braves bourgeois d’alors si un plaisantin avait avant leur passage semé à fleur de terre une centaine ou deux de copies du célèbre chapeau de Napoléon ? Humour, sans doute, qui aurait pu être d’un surréaliste belge et accompagner les pluies d’hommes porteurs de chapeaux melon sur la banlieue bruxelloise. De ces hommes-là, qui de nos jours ont simplement changé d’attirail vestimentaire pour habiller ce que Wilhelm Reich nommait leur « cuirasse caractérielle », on ne ressent que dégoût lorsque fascinés par les idéologues du biopouvoir et les technocrates du transhumanisme, ils se proposent de lotir telle une station balnéaire, l’éternité à jamais partageable avec les progrès conjugués des neurosciences, de la biochimie et de la robotique. Délesté de ses ébauches mécanicistes, l’homme-machine tente toujours de s’offrir un futur à l’image de son présent, où la mort, pour quantifiable qu’elle soit à tous les niveaux de l’économie, depuis le casse-tête domestique jusqu’au spectacle, aujourd’hui renouvelé, des épidémies mondiales, doit être de plus en plus abstraite, de plus en plus impensable, pour devenir irréelle et ainsi, être abolie. Aussi, parce que nous avons plus que jamais le désir et l’urgence de changer la vie, nous avons à observer au contraire la présence de la mort comme un fait de nature, pour mieux nous défaire des malédictions civilisées de Thanatos, que ce soit l’accablant memento mori des chrétiens ou le rôle de l’instinct de mort dans la dynamique du principe de réalité. Le Nécrophile de Jean Benoît rôde toujours dans les rues et les chambres que nous traversons. Et reste encore très énigmatique cette phrase du premier Manifeste du surréalisme : « Le surréalisme vous introduira dans la mort qui est une société secrète. » Sur le chemin de l’arcane dix-sept, il y a l’arcane sans nom, qui illustre si bien la recherche surréaliste des fossiles instantanés du devenir humain.
21-27 juillet 2020