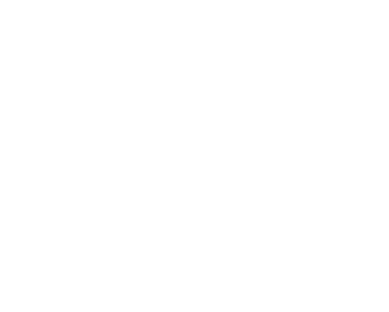Guy Girard
MISE SOUS TENSION
Tout voyage, s’il ne se réduit pas à un simple déplacement dans l’espace mû par de banales et trop souvent imparables nécessités, se révèle pouvoir avoir une dimension initiatique. Et à moins de se comporter en pèlerin de quelque cause première ou finale, en dévot d’une quelconque croyance – religieuse ou non – cette dimension qui offre à ressentir l’expérience du monde en une efflorescence symbolique superposant les mille accidents de la réalité aux inclinaisons souterraines du cœur et de l’esprit, ne s’épanouit d’abord que de façon inconsciente avant de se manifester par ces signaux perturbateurs que sont les sentiments de déjà vu et les hasards objectifs. L’esprit du voyageur, ainsi éveillé, peut dès lors se saisir du poème du monde, poème toujours inachevé, que nos prédécesseurs ont pu nommer surréalité, quand Victor Segalen, depuis la Chine encore impériale, le vivait dans l’expérience du divers.
Initiation : itinérance, itinéraire. Là où nous voulons aller, là vers où nous nous sentons plus ou moins confusément appelés est paradoxalement, pour reprendre le titre d’un beau livre d’André Dhôtel, le pays où l’on n’arrive jamais. Il y eut tous ces voyages en effet initiatiques, tous ces départs vers quelque paradis d’autant plus inoubliable qu’il était imaginaire, ces Atlantides et ces royaumes de la Reine de Saba ou du Prêtre Jean, ces îles Penghai et ces montagnes au sommet du monde où vivent, dit-on encore aux enfants, les dragons… Nous avons certes conservé la mémoire de tous ces voyages, pour autant qu’ils alimentent nos imaginaires au point de pouvoir oser affirmer que nous sommes aussi leurs points d’arrivée : Marco Polo se repose enfin dans nos rêves, attendant une carte postale de son vieil ami Philéas Fogg.
Mais la possibilité du voyage aujourd’hui, quand des peuplades entières de crétins se livrent aux joies frelatées du tourisme, que ternissent maintenant quelque peu l’épidémie de covid 19 et les angoisses subséquentes, quand un de ces monstres à face humaine qu’on nomme milliardaires se vautre dans les bénéfices escomptés du tourisme spatial, quand aux cartes de l’île au trésor se sont substituées les applications de géolocalisation par satellite disponibles sur cette prothèse électronique que chaque bon citoyen se croit tenu d’avoir dans sa poche, qui au contraire de celles de Rimbaud, ne seront jamais trouées – ni d’ombre, ni d’azur – ? Le voyage commence au sortir du lit, le matin, chaque matin si l’on a gardé à l’éveil et ensuite lors des déambulations quotidiennes, quelque trace archaïque, repérable dans les inattendus moments de conjonction entre imaginaire et réel, des vagabondages auxquels se livrèrent pendant des milliers et des milliers d’années nos ancêtres préhistoriques. Tous alors étaient nomades, comme l’étaient encore il y a quelques décennies les aborigènes australiens ou les Inuits, et comme persistent à l’être, malgré la misère inhérente à leurs errances obstinées sous nos latitudes post-industrielles, certains tziganes. De ces déplacements continuels qu’avaient tous ceux-là, migrant de terrain de chasse en terrain de chasse sous des cieux qui n’auront jamais autant été étoilés en accord avec les paysages traversés, tels qu’ont pu nous les rendre imparfaitement à nos entendements citadins, le chant des pistes des peuples de l’Alcheringa, je gage qu’il nous en est resté quelque reste immémorial, qui est ce nomadisme psychique qui est la marque de la pensée poétique dans son opposition avec la pensée rationnelle dominante, d’autant plus dominante qu’elle réduit le monde à un langage binaire fait de suites de uns et de zéros.
Nomadisme psychique qui peut certes choisir d’apparaître, comme pour Baudelaire, sous le voile de la nostalgie des îles lointaines. Mais cette disposition d’esprit héritée du romantisme lui révéla aussi que le vent donnant aux palmiers tropicaux leur balancement d’odalisque pouvait aussi souffler, comme par inadvertance, dans les sages futaies du jardin du Luxembourg. De même que peuvent se confondre moments de la vie éveillée et images de rêves, peuvent s’entremêler le proche et le lointain, lieux d’ici et de là-bas : la condition première du dépaysement est paradoxalement de pouvoir reconnaître en un pays lointain de secrètes analogies avec le lieu d’où l’on vient. L’étrangeté de celui-là révèle une dimension restée jusqu’alors mystérieuse de celui-ci, qui a son tour exaltant les différences avec le pays lointain, accuse en nous la sensation d’être vraiment et librement ailleurs. Cette sensation ne va pas sans induire un trouble des plus fertiles, qui amène à constater au fond de soi une transformation qualitative de notre être-au-monde, d’étendre le sentiment de son identité propre à la prise de conscience d’une virtualité jusqu’alors ignorée. Le fameux « je est un autre » se donne ainsi à comprendre et à vivre, comme aussi s’allège de son fardeau névrotique ce qu’Ernst Bloch nomme le « non-encore-être ».
Lorsqu’en 1992, les surréalistes parisiens proposèrent à leurs camarades étrangers de signer une déclaration internationale dénonçant vigoureusement les célébrations officielles du cinquième centenaire de la « découverte » de l’Amérique par Christophe Colomb, ce texte élaboré à partir d’un canevas de notre amie argentine Silvia Guiard et qui fut publié dans le second numéro du Bulletin Surréaliste International, nécessitait un titre percutant. L’un d’entre nous proposa pour cela une citation d’André Breton tirée des Prolégomènes à un troisième manifeste de surréalisme ou non, citation puisée dans une édition de poche des Manifestes, laquelle comportait une magnifique coquille que nous ne remarquâmes que trop tard ! C’est ainsi que cette déclaration internationale fut titrée « 1492 – 1992, Tant que les voyageurs parviendront à se substituer aux voyants », tandis que Breton opposait à ces derniers des voyeurs ! Les conquistadors peuvent certes être accusés de pires crimes que celui de voyeurisme ; par contre les voyageurs d’aujourd’hui, adeptes du tourisme de masse, qui promènent leur bedaine aux quatre coins du monde, aiment souvent à savourer les joies malsaines de contempler, et guère loin de leur hôtel, la vie misérable des autochtones : voilà l’occasion de belles photos pour inonder les réseaux dits sociaux !
Voyant, voyageur : la quête poétique, depuis la modernité, a emprunté tour à tour, et souvent entremêlé ces deux voies d’accès à la connaissance par l’épreuve d’une beauté encore inconnue. A la Prose du transsibérien et de la petite Jeanne de France de Cendrars a répondu le Voyage en Grande Garabagne de Michaux : le premier, voyageur impénitent, a traversé (mais d’aucuns doutent qu’il l’ait vraiment fait) une Sibérie infestée de bagnes quand le second, en son exil intérieur après quelques décevants voyages, s’est préservé tant de l’idée de poursuivre ceux-ci que de trop espérer de ses explorations infrapsychiques : gare au bagne, et gare à tout enfermement, que ce soit dans le monde extérieur ou dans le monde intérieur !
Il ne s’agit pourtant pas d’estimer, à la suite de Pascal, que tout notre malheur viendrait de ce que nous ne savons tenir en place, dans notre chambrette. De toute façon, les voisins sont bruyants, et par la fenêtre, j’aperçois, sans trop d’efforts, par exemple, le Tibet. Il est vrai que j’ai à diverses reprises, et à différentes époques de ma vie, rêvé que je voyageais dans ce pays. Effets de la lecture, en mon enfance, de Tintin au Tibet, et plus tard des livres d’Alexandra David-Néel ? Mais je n’y suis jamais encore allé, cependant qu’un soir du printemps 2016, séjournant en Chine dans la province du Guizhou, tandis que je m’attardais à regarder le coucher du soleil par-delà les montagnes, je songeais que Lhassa n’était en fait, à vol d’oiseau, distant que de cinq ou six cents kilomètres. Voyage imaginaire dans le voyage réel, comme si celui-ci n’avait d’autre intérêt que de servir de tremplin à l’onirisme éveillé. L’épreuve de la réalité dès lors qu’elle échappe à toute routine, donne allègrement libre passage aux sollicitations de l’imagination, qu’accentuent bien sûr l’écoute d’une langue étrangère, la découverte de mœurs différentes, le renouvellement des désirs par-delà le désirable. Lors d’en second voyage en Chine, cette fois dans la province du Guangzi, à quelques degrés sous le tropique du Cancer, j’observais depuis le parking de notre hôtel, l’effervescente nuit étoilée. Un client de l’hôtel vint partager ma contemplation et en chinois il me nomma les principales constellations, vocables que je tentais de répéter après lui pour m’en souvenir, cependant que je retrouvais, tant bien que mal, leur nom équivalent en français. Il me sembla alors que ces étoiles brillaient d’un éclat différent, d’avoir été nommées dans cette belle langue étrangère, éclat témoignant sans doute de cet échange inattendu et tel un poème à deux voix.
Brève fut l’harmonie originelle entre le ciel et la terre, comme entre le macrocosme et le microcosme humain, et comme en celui-ci entre le conscient et l’inconscient ; le propos du surréalisme, qui persiste à exalter les géniales intuitions de Fourier, manifeste les potentialités d’une harmonie recouvrée, à la semblance des mythiques pouvoirs perdus du psychisme que l’automatisme, selon Breton, permet de revivifier en des rituels poétiques et ludiques. Cette harmonie désirable est comme l’envers de ce monde inversé, elle s’annonce dans l’expérience du merveilleux qui place chacun de nous, face à l’ombre du temps, là où s’abolit la distance entre voyage et voyance.
18 juillet 2021

Guy Girard, “the nomadic mountain”