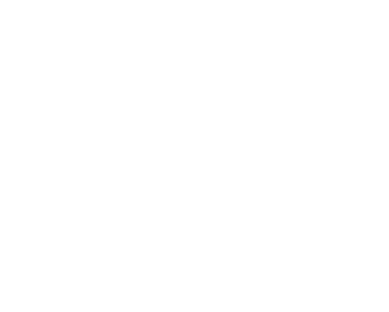Gilles Latour
La trompette et l’accordéon
Le vélo vertical
du schizophrène éreinté
traverse en grognant mais sans autre commentaire
les portes fermées
c’est alors que l’imposture du prestige de nos eaux communes
est révélée
et la flambée soudaine d’une marche militaire
le saisit par les orteils
qui traînent dix fins sillons de sang
sur un plan impeccablement horizontal de crème pâtissière
au moment même où retentit une sonnerie de cuivre
qui secoue sans ménagement les tiges de céleri ébouriffées
debout comme des minarets chevelus
dans la soupe du prophète
fort heureusement son cercueil de dentelle noire plastifiée
nous permet d’assister au pourrissement très graduel
du guide édenté
et cela se déroule avec la somptueuse lenteur d’une préhistoire
sous le ciel encombré d’anges fébriles
qui se tirent la barbiche en jouant du coude
devant une pyramide d’écrans flottants où on passe en continu
des pornos sumos
on croit voir débouler des nuages cumulus
mais rien de tel, en réalité
puisqu’il s’agit tout simplement de quelques gros derrières tavelés
qui s’agitent mollement sur les pages enluminées
d’un immense livre d’or
ouvert à la page de la fête de l’Action de grâce
avant de se ruer vers une mort incertaine
où on respire un air jaune
comme le hurlement goulu des loups
ou l’ultime plainte du soufflet
de l’accordéon épuisé,
comme une forêt.
Dieu débarrasse la vaisselle
Laissons l’âme en paix
dans son cimetière de ouate épaisse
et allons plutôt vivre en Finlande où on passe le balai
dans les rues et ruelles tous les jours sauf le dimanche
pour en chasser les chattes profondes qui viennent toutes les nuits
y creuser leurs nids
car de nos jours Dieu vit en ville avec sa nouvelle épouse
et son fils adulte mais un peu lent
et un vieux perroquet gris et muet,
c’est qu’il abhorre le vide de la nature
Dieu,
et qu’il se vide comme un putois qu’on vient d’égorger
surtout qu’il vient de découvrir qu’il est atteint d’un cancer du pancréas
Dieu,
et quelquefois les balayeurs lèvent les yeux au ciel
et tendent leurs bras suppliants
et leurs balais
pour déloger les nids barbelés que les corneilles ont solidement tressés
tout en haut des beaux bouleaux cracheurs
pauvre Dieu !
il a beau perdre tout le temps qu’il peut
il n’en a plus pour très longtemps
et le vieux curé de sa paroisse qui n’entend rien aux médias sociaux s’empresse de postuler un poste de fonctionnaire des postes
sans demander son reste
et à tout propos
l’autocar s’agenouille au pied des meules
et les chiens de bénitiers transis devant le spectacle grandiose des momies qui prennent la mer
en oublient d’uriner
et derrière nous les villes s’écroulent
et où elles furent ne subsiste plus qu’un gros nuage joufflu et rose
et la poussière flotte
immobile
dans la lumière d’huile car un soleil s’effraie pour si peu
il frémit il tremble il explose dans un gargouillis d’entrailles
et le ciel gras pèse lourd sur ses épaules
et un rat noir
l’accompagne désormais partout
sauf quand il entre s’agenouiller dans une église à bulbe sous l’étoile rouge mangée par la rouille
solennelle comme un poids d’horloge
la fin approche
et le regard calme des pyramides découpe en tranches sanglantes
le vol translucide des oies sauvages
qui sentent la tomate verte
à l’horizon, il pleut des aiguilles et des dents de marcassin
et les derricks sont déguisés en soliflores
les débarrasseurs de vaisselle sortent humer l’air frileux
sous leurs grands parapluies de fourrure mouillée
ils restent là à respirer profondément, près d’un minuscule cône de neige jaune chrome
et leurs chagrins sont des joies d’aurores boréales
comme la Sibérie
où on trouve des filles en robe de mariée dans tous les champs
et quelques balais de chiotte orphelins
et des paysages saccagés
de névasse
et de gadoue.
La valisette de Michaël Peu
Le chuintement d’un éclair
de fermeture
peut être un criminel figé par son cri,
ainsi ce Michaël Peu
qui s’habille de pelouses prêt-à-porter
et de contractions sérielles qui courent en petites vagues pointues comme des
accents circonflexes
sur sa peau argentée
celui-là sait parfaitement comment faire pour rester échevelé sous sa coiffure
de beau buisson brumeux
et pêle-mêle, dans une valisette sur roulettes soyeuses
tous ses rêves
car la mort a également son secteur immobilier
et sa guerre de dépotoirs
et bien plus que des rideaux de pluie sur la mer de titane, la nuée poudreuse de soi
dans son bruit blanc
ses coulées de lave et de moi incandescent
d’une beauté moyenne mais éprouvée, comme à Venise le Pont des Poings
et le sillage scintillant des dynasties en fuite
quand nous nous mîmes en voûte
vagues et flous
à l’oreille ou de mémoire
pour en rejouer quelques plats morceaux plus tard
et jouir
dans l’enclos des faux flexibles
ou sur la chaîne d’assemblage slave en lederhosen squameux
et affreusement ridés
ce putois débité en basse résolution
médite aussi sur l’échafaudage pourri qu’il démolit au ralenti dans les migraines qui l’affligent
il réfléchit aux privations des stèles qui restent couchées dans la plaine
aux pansements défaits des piscines mal cicatrisées
et à moitié remplies de sable
à leurs floraisons spontanées de cacti nocturnes qui se déchirent en une série
de petites explosions noires
– une chaleur au cœur, inattendue
tel un abîme
¡corazón loco!
et la pellicule d’huile aux relents de casquette agricole qui calme les flots de
sa peau écrémée
puis qui grimpe aux balcons aléatoires de l’arc-en-ciel ectoplasmique
aux os si fragiles
surtout depuis que la maison concave respire
enfin libre
comme un baiser que ses lèvres d’aluminium vont poser sur la cymbale
tous les matins
car ce filet drague des antennes qu’on passe une vie entière à peigner
une architecture hirsute d’attentes minées
un agrégat d’appétences mimées
une machine sans fruits
ni bruits
tandis qu’un rétracteur en acier inoxydable lui écarte les mâchoires
et qu’un forceps lui tire la langue à l’extérieur
pour qu’on puisse
la lui reconfigurer.
Gilles Latour, poète franco-ontarien, est né à Cornwall (Ontario), a grandi à Ottawa et à Montréal, a étudié la littérature et la linguistique à l’Université McGill, a travaillé dans l’humanitaire et le développement international en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, et vit à Ottawa depuis plus de trente ans. Directeur de la collection Fugues/Paroles (poésie) aux Éditions L’Interligne pendant quelques années, il est aujourd’hui consultant en développement international, traducteur et rédacteur technique. Après avoir publié des poèmes dans quelques revues québécoises, il a publié Maya partir ou Amputer à L’Interligne en 2011 et Mon univers est un lapsus en 2014 chez le même éditeur, où la sortie d’un troisième recueil, Mots qu’elle a faits terre, est prévue en 2016.